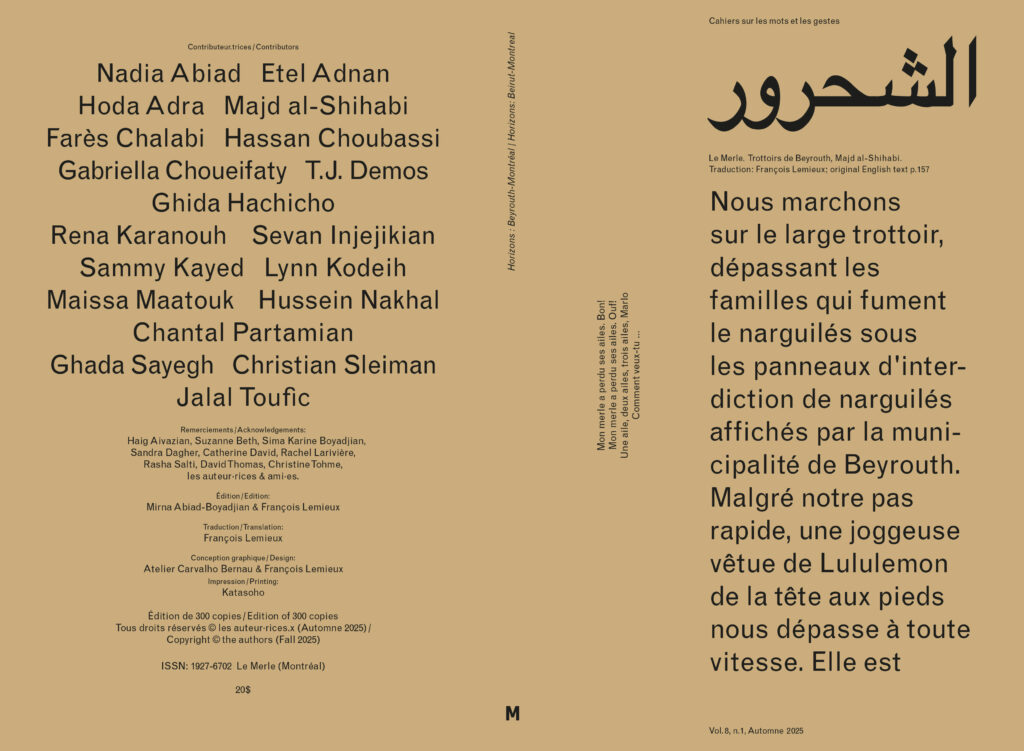12 juillet 2006, la guerre a recommencé. Elle dure 33 jours. Beyrouth se lève à l’aube sous une pluie d’obus; l’armée israélienne attaque, deux de leurs soldats ont étés capturés à la frontière par le Hezbollah. Ce film a surgi d’une image, perdue quelque part dans ma mémoire. Je ne distingue plus les contours de ce qui a été et de ce qui est reconstruit; mais je me souviens bien de ce jour-là, de l’horizon de la ville, à feu et à sang, de ce matin, dans notre appartement du quartier Sassine, qui du haut de son premier étage offrait une vue dégagée sur la banlieue sud. C’est notre chienne la première qui a senti les avions arriver. Je me souviens de ma mère, nerveuse, qui essayait de cacher la peur que son corps trahissait et connaissait trop. Faire ses valises vite, partir dans les montagnes et, en rangeant ses affaires, sortir sur le balcon pour voir, voir ce qui est entendu.
Un ciel rouge, un cercle de feu dessus le paysage de la ville; un abcès flamboyant percé çà et là de titanesques fumerolles, une averse de lumière qui pleut. Les bombardiers israéliens tranchent les airs et crachent leurs obus. De spectaculaires excroissances de feu et de poussière prennent vie, se cristallisent et se propagent. Les immeubles chutent, se résorbent dans les entrailles de la ville, et ne laissent plus qu’un gouffre béant de gravas. Glas infernal, les bombes claquent comme des orages maudits.
L’image du paysage apocalyptique porte en elle une double actualité, le spectacle de terreur annonce l’inavouable, l’implicite des corps pliés, des corps pilés, des corps morts annihilés sous l’impact du béton qui tombe, et dont le cri est impossible à entendre sous le vacarme de la guerre. Dans le film, les archives d’horizons bombardés sont ainsi utilisées comme une double image; d’un côté, faire contraste à la chair vivante, nue et belle; de l’autre, comme une image manquante 1 … celle du corps déchiqueté qui montre (prouve, doit prouver encore) la réalité du massacre; intolérable 2, pornographique, impossible à regarder en face.
26 juillet 2006. Le film a lieu ce jour-là. Entre-temps deux autres évènements ont aussi lieu : d’abord la mort accidentelle, visible et diffusée de quatre casques bleus de l’ONU sous des obus israéliens — indépendamment des centaines de civils anonymes déjà tombés. Ensuite la Conférence Internationale de Rome, coprésidée par la secrétaire d’État américaine Condoleeza Rice (qui énonce la veille à la télévision cette formule célèbre : « Il est temps pour un nouveau Moyen-Orient ! »). De cette réunion, qui a pour double objectif d’obtenir un cessez-le-feu immédiat et de mettre en place une force multinationale au Liban, ne sort aucune résolution 3.
***
Janvier 2018, première version du scénario. Ce qui provoque l’étincelle originelle, c’est une force de prise de conscience sourde, le gouffre énorme qui existe entre mon souvenir de cette guerre et sa réalité gore. Au départ, le film doit s’appeler Les pluies d’étés 4; intitulé d’une opération militaire entreprise par l’armée israélienne dans la bande de Gaza en juin 2006. J’ai choisi d’appeler le film 2006, pour considérer cet évènement comme une date historique 5, une date tournant 6; époque passée, manifestement actuelle 7. J’envisageais d’amorcer une réflexion sur ce qui est révolu, ce qui ne fait que commencer et ce qui n’en finit pas de revenir; mais je souhaitais surtout questionner la notion d’unité nationale quant à cette guerre qui n’a fondamentalement pas été subie de la même manière 8; pour moi, sonore, dans les montagnes épargnées, que pour toi, palpable, dans le sud dévasté.
En 2006, l’horizon politique est bipolaire et se partage entre deux forces, le Hezbollah d’une part, et le Courant du Futur de l’autre, dont le chef de file devient Hariri Fils 9. Le premier à l’oeil sur le passé, dans l’attente imminente de la libération des terres toujours occupées par Israël; le second, l’oeil sur le futur, effaçant frénétiquement les traces de la guerre civile en projetant et aménageant le marché libanais sur la scène globale 10, en attendant que justice soit faite et vérité dévoilée 11 Cette bipartition n’offre aucun présent habitable, aucune action politique possible, ni aucun mouvement concevable 12. Dans ce contexte, la guerre de juillet, éclat d’une autre, atemporelle et métastase, est un événement particulier. Bien qu’ultramédiatisée, elle donne lieu, en raison de sa nature sectaire 13, à une expérience collective fragmentée, générant des expériences diverses, dépendamment de nos coordonnées idéologiques ou géographiques, tout en entérinant les clivages entre les différentes communautés en place 14.
Farès Chalabi, théoricien de l’image sectaire 15, présente dans son texte éponyme ce qu’il conçoit comme une esthétique sectaire. Il part de la description du système politique en place pour tenter de théoriser les formes artistiques qui lui serait caractéristiques. Par exemple, la structure double de montage image-image (ou texte-image) d’oeuvres réalisées par Walid Raad :
«Cette structure de l’image fait écho à l’organisation politique du système sectaire libanais […] la constitution actuelle porte cette dichotomie entre un statut civil, citoyen, où tout individu est égal en droit à tout autre individu, et de l’autre un statut confessionnel où les individus sont soumis aux droits religieux, mais aussi où certaines fonctions publiques ne sont accessibles qu’en fonction du quota confessionnel. Cet amalgame du démocratique et du confessionnel caractérise le système sectaire, un système où il y a une ligne quotidienne-citoyenne et une autre ligne historique-confessionnelle – un dédoublement politique qui reprend la structure de la cécité psychique évoquée plus haut, un monde où l’on a pas vécu la guerre, et un autre monde où on a vécu la guerre.» 16
En suivant cette architecture, la situation de départ du film est celle d’un monde en guerre où l’on n’a pas vécu la guerre et où, par conséquent, tout se dédouble.
***
La trame narrative repose sur une structure dualiste où sont collées ensemble deux réalités simultanées et corrélées; la grande histoire, celle de la guerre de 2006, et la petite, insignifiant évènement domestique, rite de passage adolescent universel et mythologique, à savoir, une scène de voyeurisme sexuel. Ainsi, la caméra suit le quotidien et les tensions de trois personnages, une mère et ses deux filles adolescentes, refugiées dans les montagnes qui surplombent Beyrouth. Il me semblait intéressant d’aborder cet évènement du côté de ceux qui n’en sont pas victimes mais témoins 17, ceux qui sont fait « spectateurs » malgré eux, et qui de surcroit, n’en parle pas ou plus 18. En effet, aux premiers jours, le gouvernement israélien annonce qu’il ne bombardera que les régions attenantes au Hezbollah, offrant l’opportunité à une partie de la population d’assister, de pas-si-loin, à la chute des voisins. Les personnages incarnent donc ce que Walid Sadek, à ce propos, baptise The witness who knows too much 19. Ce personnage conceptuel 20 s’ancre dans la structure sectaire du système politique libanais qui dessine les lignes d’un partage de la terre à l’intérieur de frontières déjà problématiques. J’ai trouvé pertinent, de transférer cette structure perceptive dans les yeux d’une jeune fille pubère (la plus jeune soeur, Sariah 21 ) – par essence atteinte d’une pulsion de curiosité.
J’ai ensuite tenté de dédoubler ce point de vue à travers le dispositif critique d’une conscience caméra 22. J’ai cherché à mettre en place un mécanisme d’objectivation qui divise le montage entre le point de vue subjectif du personnage-mouvement (Sariah) et celui objectif de la caméra pensante, vivante, critique. Je voulais décrire une facette de cet évènement à partir du prisme de la fiction, tout en posant le problème de la perception dans le contexte d’une expérience collective mais fragmentaire 23. Je voulais également que la distance thématique que j’aborde (voir la guerre, vivre la guerre; voir l’immeuble qui s’effondre où être en dessous) et qui viens se poser entre les personnages et l’évènement, soit cristallisée dans la forme, en filmant principalement à la manière d’un observateur lointain.
La question du point de vue a été centrale dans les étapes d’écritures. Ce film est un cas d’école en matière de production indépendante, ce qui veut dire qu’aux différentes étapes de sa confection, en raison de l’investissement financier, différents acteurs ont eu un droit de regard. Après la première version du scenario, je suis passée par une résidence / atelier d’écriture. Ces structures s’érigent comme des pépinières de formatage dramaturgique et leurs stratégies d’aide à la création ne sont qu’une longue liste inhibitrice de tue-l’amour; c’est-à-dire, une lente et menaçante pression pour que vous corrigiez le film selon des normes imaginaires, subjectives et commerciales, tout en vous promettant que vous, auteur-réalisateur, si ! vous avez la chance d’être parmi les élus dont le film est financé, aurait bien entendu le dernier mot à la fin (quand il est déjà trop tard hélas…). Il fallait avoir un point de vue centré; les films « chorals » ou simplement les films différents, étant trop ambitieux pour le circuit ordinaire de la production et distribution cinématographique.
En 2020, j’ai signé un contrat de droit d’auteur avec la boite de production. Il a fallu en tout quatre ans pour réunir les fonds nécessaires; en commençant bien entendu par une averse de refus, contrée par le producteur par une stratégie de remaniement des différentes versions que j’ai largement eu le temps d’écrire; pour pondre un patchwork qui plairait aux financeurs, et donc une version où la présence de l’éveil à la sexualité était prépondérante — mêmes financeurs qui ont étés déçus par le résultat final du film; la guerre OK, mais pas assez de sexe, pas autant que promis. Tout ça pour pouvoir tourner dans les environs de Beyrouth tel que je le souhaitais. Il aurait été logistiquement et financièrement beaucoup plus simple de tourner en France ce huis-clos, vu que la quasi-totalité des fonds viennent de là. Mais, c’était pour moi conditio sine qua non de tourner en terrain connu et avec des techniciens locaux, la post-production devant obligatoirement se passer dans les régions françaises qui ont aidé à financer le film, comme le stipule leurs conditions de retour sur investissement.
Le point de vue dédoublé s’organise autour de trois types de plans au niveau formel; les larges tableaux avec une caméra à distance qui suit tous les personnages, les gros plans sur le visage de la voyante/voyeuse Sariah, et les images haptiques saccadées obsessionnelles qui représentent son point de vue subjectif. En plus de cela, la perception se divise entre une vision microscopique de l’intérieur de la maison, image numérique et anamorphique ; et une vision macroscopique retransmise à travers l’archive de guerre en format 4/3, qui est le seul horizon visible 24. A cette époque et dans le film, la télévision et la radio sont allumées en continue 25, tous les jours on se raccroche aux nouvelles 26. Le petit écran dans le grand, cette mise en abyme organise la première couche du montage, imbriquant deux réalités dans une seule. Les images de cet ailleurs, ce juste à côté où tombent les bombes israéliennes, deviennent le double du réel immédiat et palpable, qui en conséquence se fond dans l’artifice 27. Ce qui entre en jeux est le rapport d’échelle, de proximité et de distance avec l’évènement de la guerre. Elle devient une présence/absence, présence/distance; ce quelque chose que l’on oublie parce que le temps passe et qu’on s’habitue à tout; elle devient un son qui nous surprend, sursaute, parfois, souvent, dès que l’occasion se présente, qu’un quelconque objet se brise à terre ou que quelque chose chute, dehors, et nous rappelle en un instant que la guerre est là, qu’elle se défend d’être justifiable et qu’elle s’affaire à tuer et à détruire, encore, et toujours.
La deuxième couche du montage est celle d’une disjonction entre l’image et le son, où les bombes en hors-champ viennent compléter et changer le sens des images du quotidien 28. Le travail du son a été reparti en trois strates, d’abord le son synchrone in situ de l’intérieur de la maison, ensuite le son off des bombes qui explosent au loin, et enfin une création d’ambiance qui représentait pour moi le « son de la guerre », fait d’une superposition d’enregistrements d’instruments éclectiques et de sons de moteurs de divers appareils ménagers composé par Shakeeb Abu Hamdan. Des archives radio jalonnent également l’ensemble du film et informe le spectateur du contexte à travers une écriture médiatique. Une clause d’un des fonds de financement qui nous a été attribué, stipulait qu’il fallait que le film soit à plus de 50% en langue française. Nous avons donc traduit l’intégralité des archives radio en français, ce qui dans un pays sous ex-mandat, et dans le contexte d’une recolonisation 29 actuelle évidente, faisait sens – en ajoutant à cela le fait qu’une grande partie des antennes de transmission radio ainsi que les bureaux des différentes chaines de télévision ont étés systématiquement détruits par l’armée israélienne. Cette solution me plaisait d’autant plus que cela avait pour effet de créer un double discours, celui des personnages dans la langue vernaculaire, et au-dessus, celui des médias, dans la langue hégémonique, qui viens les faire taire.
Le personnage de Sariah n’a que trois répliques dans le film, mais elle a un regard; impassible 30. Mona-Lisa imperturbable, à l’inverse du Cri de Munch ou des portraits de Bacon, son visage ne nous dévoile rien de ce qui se passe à l’intérieur d’elle ; impossible de déchiffrer l’affect qu’a sur elle le contre-champ des images de la guerre. Au début, je voulais diffuser dans le poste tous genre d’images (images intolérables mêlées aux dessins animés, aux pubs de vaisselles etc 31 ), mais j’ai vite compris que ce qui m’intéressait n’était justement pas ce montage dispersif, critique de la « société du spectacle » et de la consommation rapide, notamment sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Plutôt, en alignant ces images qui se ressemblent et semblent se répéter à l’infini, hier, toujours, encore aujourd’hui les mêmes, celles d’un horizon d’une ville bombardée; dans les vues sans cesse renouvelées de ces morts et destructions, de ces nuages et déflagrations de poussière, de ces traits de lumière, je pensais voir une esthétique en formation, le dessin d’une culture qui, à nos corps défendants, cherche à se faire notre.
La prémisse esthétique du film est celle du questionnement de la relation que nous, en tant que spectateur, en tant que voyeur, entretenons avec ces images intolérables. Je voulais faire un film qui aborde et questionne l’écart qui existe entre l’image et la réaction, ou la non-réaction, entre l’image et l’action, ou la non-action. Lors de l’altercation avec elles, je ne sais pas réagir, je ne sais pas ce que je ressens, un mélange d’émotions entre terreur et pitié qui n’a rien de cathartique. Mes liens sensori-moteurs se relâchent 32, il y a une impossibilité de prolonger la perception par l’action 33. Comment agir alors, quand la vie continue tout en semblant impossible? Quand on est destitué de ses capacités motrices par un contexte qui est lourd, une image qui est trop insupportable, quand on est face à un excès, à une saturation de l’espace 34? Comment passer son temps ? Comment gagner son temps ? Comment perdre son temps ? Ce « que faire » 35 mythique, il me semblait intéressant de l’aborder à travers des personnages qui justement, ne savent pas quoi faire… 36 ou ne peuvent rien faire… d’autre qu’attendre.
Un temps de guerre est long, lent et arraché. La troisième couche du montage est celle de la restitution de ce rythme particulier, de cette langueur, ce temps lourd, faible, mort ; en tentant de faire rentrer ce temps long dans le temps court du film. Pour cela, ce dernier travail s’est axé autour de deux points essentiels : la durée et l’ellipse. Afin d’arriver à la continuité du temps long, il fallait que le montage annule l’ellipse temporelle, qui est son essence. J’ai écrit le scénario comme un puzzle, faits de séquences indépendantes et décousues bien qu’elles suivent un axe linéaire. Je souhaitais pouvoir casser la trame chronologique et avoir la possibilité au montage de prendre, mettre, remettre n’importe quoi avant, après n’importe qui. J’ai beaucoup expérimenté et il semblait que plus je tentais de me départir de cette chronologie, plus justement je perdais le rythme de ce temps long qui n’arrivait tout simplement pas à prendre autrement. J’ai également pris la décision de ne mettre aucun noir afin de donner l’impression d’un flux continu. Le but et le défi, était justement de réussir à ne pas représenter, ni illustrer le non-passage de ce temps, mais justement de faire ressentir, réussir à mettre le spectateur en présence de cette temporalité, en 24 minutes.
Je souhaitais travailler ces idées autour d’une ellipse conceptuelle qui est celle de l’évènement, en m’inspirant de la manière dont les péripéties politiques au Liban s’enchainent sans jamais être adressées. J’ai donc d’abord choisi d’éluder systématiquement toutes les actions et de faire en sorte que ces élisions deviennent la coupe et la transition entre chaque séquence fermée. Restent, soit les préliminaires soit l’après-coup, le déjà trop-tard 37, le on ne peut rien faire… ; séries de non-actions ou d’actions périphériques et passives 38, tout ce qui semble ne mener à rien 39 en termes d’intrigue. J’ai éludé l’évènement majeur de la grande histoire, à savoir la guerre, tout comme celui, insignifiant de la petite histoire (ils n’en parlent pas). Durant les périodes d’écriture, un des points majeurs de discussion est justement le fait qu’il fallait que l’évènement de voyeurisme soit adressé dans la narration, qu’il fallait qu’il y ait une réaction et qu’à l’inverse, le film serait plat, inachevé, sans aucune tension ni conflit, et donc qu’il passerait à côté de la nature même du cinéma. En effet, le film de cinéma par excellence est celui qui fait de l’évènement son essence, son mode d’opération et de monstration. Mais à l’inverse, je voulais que le film traduise une vérité qui est propre et fidèle à l’expérience qu’elle dépeint.
L’histoire du Liban est une liste de catastrophes sans suites, de désastres qui « passent » parce qu’ils sont systématiquement ignorés par le pouvoir qui se maintient en place et se perpétue grâce à la stratégie de l’impunité. Les séismes qui se succèdent depuis la fin de la guerre civile n’ont pas été pris en charge par une justice qui semble cruellement absente dans notre coin du monde. De la loi d’amnistie de 1991 qui soustrait les responsables des crimes de guerre à toute forme de responsabilité, tout en leur redonnant le pouvoir ; à la politique violente et hâtive de la reconstruction, aux séries d’attentats et d’assassinats politiques qui ont suivis, à la faillite de l’état en 2019 ou encore, à la bombe irrésolue du 4 août qui fait des centaines de victimes sans aucun coupable. Pas d’état, pas de justice, on attend la prochaine catastrophe et il est impossible de se projeter ou de construire quoi que ce soit.
Avant le 7 octobre et que ne tombent les masques du massacre colonial, du génocide à la télé, je ne pensais pas que la guerre allait reprendre. Le film s’est tourné en juin 2023 et sort en Octobre 2024, au même moment où la guerre qu’il aborde reprend 40, 18 ans plus tard, encore 41. Il trop tôt pour voir ce que nous réserve L’ère américaine 42. Aujourd’hui nous sommes en avril 2025. Israël continue de violer impunément les accords de cessez-le-feu, en Palestine, au Liban et en Syrie, et de tuer, tuer, tuer, encore, debout, fier et fou dans un bain de sang. Gaza.
Il est communément admis que les artistes ne veulent, ne peuvent, ne doivent, trop expliciter leurs travaux, au risque d’en vider la substance et la poésie. J’emmerde ceux-là.
En mettant en scène l’implications des clivages sectaires dans les sphères de l’intime, ce film, qui prend pour mode opératoire la force critique de la description, se veut surtout comme une réflexion sur les régimes de perception actuels. Ce qui m’intéresse c’est le rapport qu’on entretient avec les images médiatiques contemporaines, plus particulièrement le genre de l’image intolérable et sa relation avec le concept de « Beauté » 43; les manières dont l’Histoire et l’information se rencontrent, et la question, dans la continuité d’un leitmotiv de l’art libanais, qui tourne autour de la représentation possible ou impossible d’un événement historique violent 44.
J’utilise l’archive en contrepoint de l’image mise en scène et fictionnelle, de la même manière que l’on regarde le monde aujourd’hui, un oeil devant nous et un oeil sur notre téléphone. Si jusqu’à maintenant rien n’empêche les bombes de pleuvoir, force est de constater que le monde est divisé en deux, là où elle tombe et là où elle ne tombe pas. S’il fallait une dernière image pour décrire ce film, je donnerais celle d’une route où il se mettrait à pleuvoir, mais uniquement d’un seul côté, comme si on pouvait voir la limite de la tempête où le début du nuage ; il pleut à gauche, il ne pleut pas à droite, mais il fait humide partout.

 Added to Cart
Added to Cart